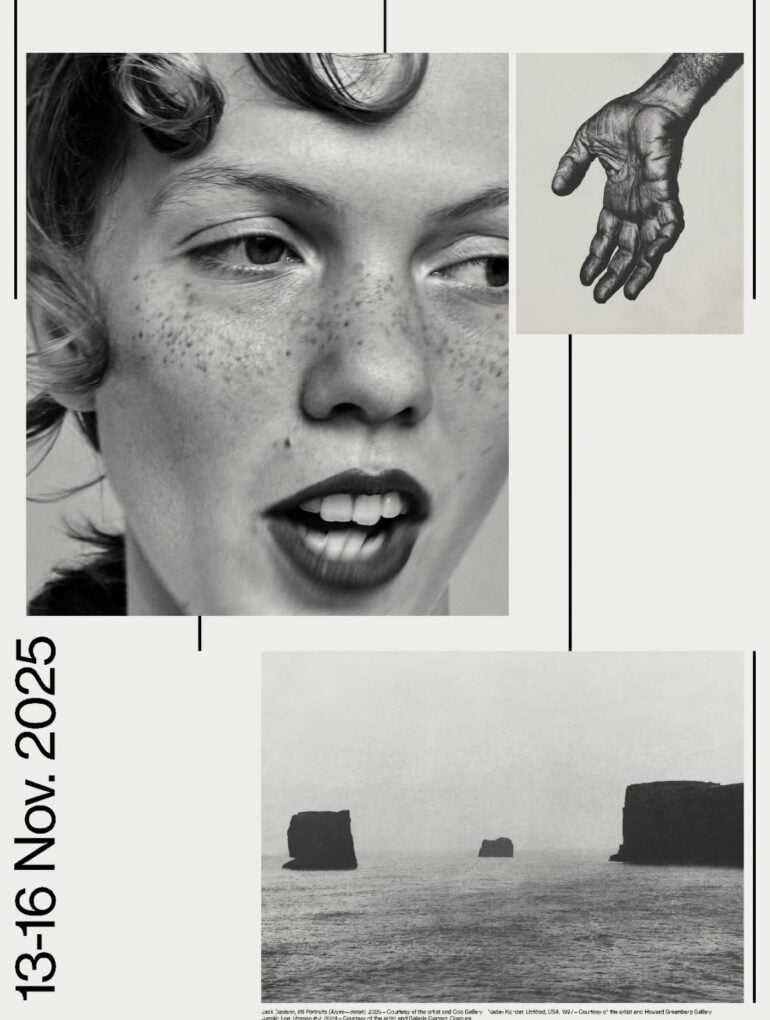
Passé le contrôle à l’entrée du Grand Palais, un plan ouvert dans les mains, se pose la question de comment visiter Paris Photo. Déambuler au hasard des allées sous la lumière tamisée de la verrière, l’œil attiré et conquis par le plaisir toujours renouvelé de retrouver les tirages d’époque ou récents de photographes qui ont marqué l’histoire de la photographie (Les Douches) ? Se laisser séduire ou intriguer au gré de ses pas par les découvertes ou redécouvertes, noir et blanc ou couleur, de Paolo Gioli, Daido Moriyama, Alain Fleischer…, par la Turquie des années 1950 de Yildiz Moran (Galeri Nev), par le jeu étrange de Solienne, « IA biographique », créée par Kristi Coronado, exploratrice de la conscience et de l’identité dans une relation collaborative, par les reconstructions d’images historiques de Brodbeck et Barbuat ? Plonger dans la collection The Last Photo d’Estrellita B. Brodsky, avec After Richard Serra. Pictures of Dust de Vik Muniz, les Silueta Series d’Ana Mendita, Elle était là d’Esther Ferrer, Je suis femme 2 de Rezvan Zahedi,… ou gravir les escaliers pour explorer les « Émergences » ?
Avant de réfléchir au choix de flâner, se perdre, d’avancer et revenir au hasard du regard, le large panorama, comme un travelling dans les œuvres grand format de Sophie Ristelhueber (Poggi), questionne l’époque troublée et ce que l’image, dans le champ et le hors champ, peut signifier ou ne pas signifier. Avec ces cicatrices des paysages et des corps qui plongent le présent dans ses passés complexes, s’ouvre, avec Les Filles du Calvaire qui a choisi de n’exposer que des photographes femmes (Nelli Palomaki, Katrien De Blauwer, Laia Abril, Helena Almeida, Diana Markosian, Karen Knorr, Lore Stessel, Marie Quéau, Katalin Ladik), une première piste d’exploration, le parcours « Elles x Paris Photo », plus d’une trentaine de galeries, sans compter les éditeurs, proposant en mixte ou en solo le travail de femmes photographes. Impossible de les citer toutes, on pourra se reporter au site où Devrim Bayar, la commissaire qui a conçu le parcours, présente un ensemble d’œuvres de Dora Maar, Lisette Model, Cecilia Mangini, Agnès Varda, Sara Facio, Martha Rosler… à Jenny Rova, Mika Horie… Difficile de dire si de cette diversité il se dégage un regard globalement différent, mais en émane une richesse sensible dans le questionnement de l’invisibilité féminine, notamment immigrée (Hélène Amouzou, Autoportrait, Molenbeek, Carole Kvasnevski ; Anna Turbau, Emigrante. Rubí, Barcelona, Nordés), de la violence (Marisa González Violencia mujer. La descarga, Isabel Hurley), du travail des femmes et de la conquête, toujours à mener, de l’égalité et des droits (Pilar Aymerich, Manifestación por la despenalización del adulterio delante de los juzgados de Barcelona, RocioSantaCruz ; Carmen Winant, The Last Safe Abortion, SPBH Editions & Mack), des questions de genre (Satomi Nihongi, Tokyo Transgender), du désir, de la fragilité des rapports des hommes à l’environnement, de la spiritualité qui les lie au vent, aux roches, aux plantes et aux choses (Juliette Agnel et Flore, Clémentine de la Féronnière ; Julieta Tarraubella, Rolf Art & Tomas Redrado Art ; Laurent Millet, Binome)… C’est aussi, dans ces questionnements, toute une expérimentation sensible de l’image, de sa construction : installation de Huda Takriti (Crone), transparences d’Hélène Amouzou et de Susan Meiselas (Higher Pictures), cyanotypes de Robert Rauschenberg et Susan Weil (Stanley/Barker), papiers et cyanotypes de Mika Horie (Ibasho), collages de Hannah Darabi.
Le parcours s’ouvre à de multiples bifurcations vers les photographies des rues de Budapest de Gyula Zaránd, la Pyrite Cubique de Marina Gadonneix ou les Darkroomscapes d’Isabelle Le Minh (Christophe Gaillard), les photocollages de Justine Kurland (Higher Pictures) ou les séries de Claudia Andujar Rua Direita et O voo de Watupari avec les applications d’acryliques colorées, les Polaroïds de Corinne Mercadier (Binome). Toutes les propositions invitent à un détour, à un moment où l’image permet de s’extraire de la foule, d’entamer un dialogue, même si on peut regretter que trop peu de galeries affichent sur leur stand une information bilingue. Plusieurs interrogent l’histoire avec celle de la représentation : HIROSHIMA, Hiroshima, hírou-ʃímə, le projet photographique mené collectivement par des membres de l’Association des étudiants du Japon à Hiroshima entre 1968 et 1971 (Mem) ; les portraits peints par points en collaboration avec le Warkukurlangu Art Centre de la série Restricted Images de Patrick Waterhouse et des artistes locaux de Warlpiri, (In-Dependance by Ibasho) ; la tension étrange des teintes du township de Thokoza photographié par Sibusiso Bheka.…
Sur les balcons, le parcours Emergence ouvre, entre autres, à l’exploration des gestes et de la matérialité de la photographie, de ses substances, de ses supports. Sylvie Bonnot, dans un corps à corps sensible avec la surface photographique, décolle la peau de l’image et la drape sur de nouveaux supports (Hangar) ; Marine Lanier met en récit ses herbiers en poésie du lien entre l’humain et le vivant (Jörg Brockmann) ; Mia Weiner explore la question du désir dans ses images tissées (Homecoming) ; dans une rencontre entre peinture et photographie, Crossfade de Nicolas Dhervillers (Dilecta) fusionne en une trame narrative composition abstraite au pastel et qualité documentaire de l’image photographique…
À musarder ainsi, l’envie nait, parmi tout ce qu’on a pu voir, de chercher d’autres parcours de visite, notamment autour de l’étranger, et, après un café, à s’arrêter longuement à la terrasse des éditeurs.