États généraux du film documentaire de Lussas, 37e édition
Du 16 au 23 août 2025
Plus d'informations sur le site d'ardèche image
La question posée par le séminaire « Histoires d’émancipation » de Romain Lefebvre, spécialiste du cinéma d’auteur, documentaire et politique (dont les États généraux de Lussas — 37e édition — sont un des fleurons) : (je résume) en quoi « la pratique du documentaire […] provoque un processus d’émancipation (parfois incertain, écorché) accompli par les personnes filmées ? Celui-ci pourra être individuel ou collectif ? » « Qu’implique pour une personne filmée le fait de se libérer à travers le regard d’une autre ? » Romain Lefebvre demande : « À qui s’adressent au juste les paroles : aux filmeurs, à une communauté virtuelle, ou à soi-même ? »
Je formulerai cette question sémiotiquement : Quels sont au fond les Destinataires des films documentaires ?
La question de la place du réalisateur de documentaires est-elle du même ordre que celle de l’ethnologue qui, traditionnellement, ne publie sur les autres cultures que pour sa culture, ou celle du psy qui ne communique sur ses patients que pour ses collègues ?
Le premier film présenté est I Pay For Your story de Lech Kowalski, 2017, ancien habitant d’origine polonaise devenu cinéaste qui revient à Utica (USA), sa ville natale touchée par la crise. Il propose à ses habitants d’acheter les récits de leurs vies, de rétribuer leur histoire racontée face écran.
Les personnes filmées, la plupart noires et précaires, sont toujours Objets de stigmatisations, de rejets, de violences et de viols, sont passées par la drogue, y compris les plus dures, par le deal, la prostitution, les multiples emprisonnements, les récidives, les crimes ou équivalents. Les récits tenus devant la caméra se ressemblent, ils suscitent notre commisération devant les injustices, les exploitations, les attaques, les injures, les arbitraires (notamment par des policiers blancs, car il n’existe aucun policier noir ou hispanique) dont ils continuent d’être victimes. Victimes, elles le sont — on a envie de mettre une majuscule au V — et une révolte s’éveille en nous devant ces horreurs commises sur elles qui nous exposent sans misérabilisme, comment elles sont Objets de haines et de persécution. Nous n’y pouvons pas grand-chose hors nos applaudissements à la fin du film, étreints par l’émotion. Les questions de la salle tournent autour de la position du cinéaste, de la possibilité des énonciations d’être mobilisatrices d’émancipation.

Les énonciations répétées des histoires sont surtout de justes dénonciations d’abominations. La personne filmée s’est-elle libérée ? Le défi de toute existence au-delà de la dénonciation est, au plus profond des offenses et des traumatismes, de savoir comment dépasser, rebondir, bâtir sur des ruines. Reste, comme au fond de la boîte de Pandore, une lueur d’espérance que les enfants n’héritent pas de ces malédictions : ces mères n’ont en tête que de compenser leurs malheurs par une vie bonne pour la génération suivante. Ce serait pathétique et peut-être illusoire si à l’écran, alors que toute la famille prend la parole successivement, il y a, vivants, des témoins muets qui sont tout oreilles, tous regards et toute attention, et même tout sourire, les enfants apprêtés pour le filmage par des bijoux plastiques colorés dans leurs cheveux bouclés. Il y a là une transmission : les discours tenus sont en apparence pour le cinéaste (et ce qu’il représente), et virtuellement l’ensemble des futurs spectateurs scandalisés, mais les récepteurs actifs, sous nos yeux, ce sont les enfants dont le regard, dont le corps tout entier se tend vers celle ou celui qui parle de l’histoire de sa famille et de sa situation actuelle, ce qui peut faire pression de commuer plus tard les échecs en réussite. Ils entendent ces récits comme si c’étaient des légendes originelles dont ils/elles seront peut-être les héros.
Cela s’apparente (le mot est choisi) au premier stade sémiotique de tout conte : une commande de résoudre une négativité absolue : attaques d’innocents par un monstre, présence néfaste d’une sorcière, d’une marâtre, etc. Quelqu’un — un roi par exemple, qui joue le rôle de Destinateur — charge un enfant malingre, une pauvre servante de dénouer l’accumulation de malheurs afin que l’expérience s’accomplisse dans la lumière. Le déroulement de la narration centrée sur la performance de celui ou celle qui va devenir héroïque permet la résolution de la négativité première dans l’accomplissement du héros, de l’héroïne dans la lumière.
Cela me rappelle les moments de mon expérience de psychiatre d’enfant où je le reçois avec ses parents ensemble ou successivement, mais toujours en sa présence, car il a à entendre, sans jamais que je ne lui demande son avis, pourquoi il vient à ma consultation, ce qui se passe et qui est si douloureux pour tous, comment tous sont débordés, comment cela renvoie aux épreuves que ses parents ont subies dans leurs propres enfances qu’ils relatent devant l’enfant, comment ils ont essayé, parfois vainement, de les dépasser. L’enfant entend se dérouler le film de sa vie, ce qui l’a précédée, toute l’histoire familiale retrouvée, revisitée, invoquée, se dit avec moi et lui comme réceptacles, ce qui augure le travail qui va s’instaurer de l’aventure, ensemble, de sa thérapie dont tout le monde, celui de ses commanditaires, va bénéficier. Nous passerons du réel au symbolique dans des médiums divers (inventions d’histoires, de dessins, de marionnettes, de jeux, de scénarios avec les animaux Fisher Price, de scènes de sorcières et de vampires, de guignol), où nous allons conjurer le Mal afin qu’il ne se reproduise plus à leur niveau.
J’ai compris de ces enfants filmés comment le film documentaire, qui les avait élus comme Destinataires secrets, jouait à travers les récits de leurs parents de commande implicite, dans l’esprit de ces enfants, de construction possible d’un avenir meilleur. Comme quoi le cinéma du réel peut être reçu par certains, en particulier des enfants, comme narration d’une légende originelle (analogue aux contes qu’ils ont entendus lors de spectacles pour enfants) sur laquelle ils/elles vont s’appuyer pour déclencher une réparation dans le réel même et qui la fait passer des ténèbres à la lumière reconquise.
Chef-d’œuvre d’une vérité profonde, Les oubliés de la Belle Étoile de Clémence Davigo qui filme entre autres Dédé, Daniel et Michel. Ils furent dans les années cinquante et soixante-dix placés dans le Centre de Redressement de la Belle Étoile en Savoie tenu par l’abbé Garin. En 2022, ils évoquent, ils revivent comment ils ont été battus plusieurs fois par jour (un de leurs camarades a été éborgné, un autre est devenu sourd par éclatement des tympans du fait de gifles), torturés, humiliés, affamés, détruits, violés pour certains (le Père Garin rejoignait la nuit les enfants de 3 à 4 ans). Ils mettent en regard combien ces maltraitances (le mot est faible) ont toujours été présentes dans leur esprit et dans leur corps tout au long de leurs vies, entraînant addictions à des drogues dures, deals, braquages, emprisonnements (51 ans réduits à 35 ans), hospitalisations en HP, etc. On les voit reçus par un couple patelin de conseillers familiaux qui leur affirme les écouter « sans jugement » (!) et leur conte la parabole du diamant couvert de boue qui retrouve son éclat après l’avoir expulsée, d’où la nécessité d’en parler (à confesse ?). La cellule d’écoute a été gênée quand ils ont su que le film serait public.

Les anciens enfants (qui ont entre 60 et 70 ans) désirent rencontrer le Père Garin, qui vit toujours après avoir traumatisé gravement des centaines d’élèves. On néglige leur requête (le Père Garin est fatigué). Sur leur demande, ils arrivent quand même sur leur insistance avec d’autres à être reçus par l’évêque Monseigneur Ballot (ça ne s’invente pas), qui rechigne à apposer une plaque sur l’ancien centre, ce qui les reconnaîtrait un peu, car, dit-il, cela choquerait ceux qui « ont été heureux » d’avoir été dans ce Centre. Cela pourrait aussi choquer les villages adjacents, Mercury par exemple. (On apprend que la Poste renvoyait au Centre les lettres que certains réussissaient à mettre dans la boîte à lettres pour avertir les parents), etc.
Quels sont les Destinataires de ce film ? En premier lieu Clémence Davigo, qui dans le rôle du Destinateur a loué une maison en Savoie pour les réunir (après avoir longuement échangé avec chacun), organisé le cadre de leurs rencontres, et les a accompagnés délicatement et respectueusement. Ensuite, les Autorités ecclésiastiques, oui (sans retour véritable qu’une réception autour d’un café chez l’évêque). Ce qu’ils demandent est la Reconnaissance, la Réparation par l’Église qui continue sa dénégation qui confine au déni. Ils s’adressent aussi au Public qu’ils informent de ces horreurs subies. Mais en deçà, d’abord, surtout, ils réussissent à rompre la solitude (l’un d’eux dira qu’il n’a jamais pu dire à une femme : « Je t’aime ! » ou « Tu es belle ! ») à laquelle ils ont tous été condamnés (ne serait-ce que par des incarcérations) et se forger grâce au film une fraternité.
Chacun arrive du coup à se confier aux autres, l’un d’eux avouant enfin qu’il a été sodomisé de nombreuses fois. Non pas retrouvailles, car ils n’étaient pas aux mêmes époques, mais constitution émouvante d’un groupe d’entraide, de soutiens réciproques, d’apparentements d’affects partagés. Encore une fois, premiers Destinataires de leurs discours lors du tournage, de la vision des rushes. Le documentaire permet la mise en rapport des présences partagées autour des évocations de passés de souffrances similaires.
Mais voici un effet imprévu : un des élèves qu’on a vu à l’écran lors de la rencontre avec l’évêque, Gérard, est présent en chair et en os lors du débat à Lussas, et cela pose en direct la question des effets émancipateurs des films documentaires. Les discussions dépassent les questions habituelles quelque peu abstraites de la place de la réalisatrice, l’illusion ou non de l’action bénéfique des documentaires, les intentions du film et ses répercussions sur les personnes filmées. Cet ancien élève qui a accompagné chaque projection dans des festivals nous révèle en outre au passage que quelques minutes ont été censurées, car il y était question de nommer le Père Garin, ce qui aurait entraîné des poursuites légales contre le film qui aurait donné le nom du criminel ! Garder ces minutes aurait empêché sa diffusion.
Découragés par l’absence de cette Reconnaissance, les victimes se sont constituées partie civile pour que soit officialisé cette barbarie, qu’une plaque soit apposée sur les bâtiments de ces centres désaffectés. Mais une prescription du fait de l’ancienneté empêche cette procédure d’aboutir.
Je propose alors depuis le public de signer une lettre de soutien afin d’aider à ce que cette revendication aboutisse. Silence et on passe à la question suivante portant sur la matière filmique. L’effet se limiterait donc à des discours d’amateurs et exégètes de cinéma ? Celui-ci se bornerait à n’être que le spectacle d’une liberté passée ? Qu’en est-il dans l’univers documentaire de son effet sur l’action des spectateurs qui se limitent habituellement à leurs sensations de spectateurs ? Peuvent-ils aussi participer à l’émancipation ?
Un peu découragé, je quitte la salle à la fin des débats quand 4 spectateurs me rejoignent et m’encouragent à une action commune. Nous nous réunissons et écrivons une lettre de soutien que nous nous chargeons de proposer à l’avocate de ces plaignants, et éventuellement sur Change.fr.
Le cinéma seul n’a pas suffi pour mobiliser autre chose que des réflexions, il a fallu qu’une théâtralisation du fait de la présence d’une des personnes filmées amorce une (petite) action. Comme quoi la présence physique est source d’émancipation soit dans le film même par les rencontres qu’il provoque lors du tournage, soit par la présence moins de ses réalisateurs que des protagonistes dont le réel a été la condition du documentaire.
Mais le film documentaire peut aller plus loin quand il est le fait des personnes filmées elles-mêmes : cela a été le cas de trois films : Clean Time, le soleil en plein hiver ; Ceci est mon corps ; Elle pis son char.

Le premier, Clean Time, a été réalisé par Didier Nion à la demande de Marc pendant sa cure de désintoxication de drogues dures et de sexe pendant deux ans. Chaque jour clean est une victoire et Marc les dénombre non sans humour. Il se reconstruit à coups d’annonces de ses progrès, y compris dans sa baignoire et on est touché par son courage. Le Destinataire est lui-même qui valide ses avancées et les enregistre quasi officiellement grâce au tournage. On ne peut que s’en réjouir, à la nuance qu’il ne s’agit pas d’une thérapie, mais d’un déconditionnement. L’émancipation ne concerne que l’addiction. Nulle allusion à l’amont : la personne et ses failles qu’elle tente de colmater par des substances. Il rappelle l’ambiance new age des années 70, mais nous n’avons aucun élément sur son drame intime qui viendrait éclairer le recours massif aux drogues qui n’est jamais (ou presque) abordé. Destinataire ? Oui, soi-même s’adressant à soi-même par l’intermédiaire de la caméra d’un copain, et par-delà d’un public futur pour homologuer (quasiment comme un jury d’une performance sportive) la délivrance dont il est souligné qu’elle est provisoire. Comme praticien de la Psy, j’ai reconnu là le discours habituel des personnes addicts qui se prennent comme objets d’un discours sur soi pour s’encourager dans l’aventure périlleuse et douloureuse d’une remontée au sevrage. Qu’il y ait film ou non ne change rien. Les raisons profondes sont escamotées, dont l’examen d’une façon ou d’une autre ferait vraiment thérapie.

Ceci est mon corps de Jérôme Clément-Wilzva encore plus loin : c’est le protagoniste qui compulsivement décide de prendre la caméra. Le film est le témoignage actif d’une plainte contre l’ancien prêtre Olivier de Scitivaux, qui l’a violenté des centaines de fois (c’est au cours de son enquête qu’il prendra conscience de ce nombre). Dans la présentation, il est écrit que ce film « ausculte les microhistoires qui font la culture du viol, la mémoire comme tiroir insondable ». Nous suivons avec passion et compassion l’enquête du réalisateur qui nous prend à témoin de son avancée. Le Jérôme victime se double du Jérôme enquêteur, les deux sont portés par le Jérôme réalisateur qui dit : « On n’est pas violeur, on le devient dans le regard des autres » et « Je filme derrière moi, comme un regard derrière l’épaule ». Le Destinataire est-il lui-même comme dans Clean Time ? Mais d’autres personnages, éventuellement en split screen, apparaissent qui sont ses Destinataires dans la vie et à l’écran, comme pour nous prendre à témoin de leurs dénis : son père, sa mère.
Il s’avère qu’il leur a tout dit lors d’un repas avec eux (+ son frère et sa sœur) sans résultat notable, à part ce qu’affirme son père, un courrier qu’il aurait adressé (?) au diocèse, sans réponse. Mais, reprend Jérôme, ils ont continué à l’envoyer quand même les deux années suivantes aux colonies organisées par Olivier de Scitivaux. Quant à sa mère, elle dévie sans cesse la conversation ou s’étonne que cela prenne de telles proportions… Image saisissante, lors d’un échange à l’occasion du film, cette fois avec ses deux parents sur les viols qu’il a subis, le père se sert à table d’un morceau de fromage qu’il mange (émois dans la salle). Les Destinataires sont donc deux personnes présentes au tournage et, par-delà ces deux personnes, nous comme témoins, presque au sens juridique de leurs incompréhensions totales. On pourrait parler de forclusion tant la vérité n’est même pas logée dans leur inconscient.
Ce film, je le recommande chaudement (comme les Oubliés de la Belle Étoile) qui présente comment d’Objet d’offenses on devient Sujets de leurs transformations en se posant comme auteur direct ou indirect du récit en mots et en images de sa propre histoire. Le film documentaire est à même de jouer ce rôle que certains qualifieraient d’autothérapie.
Je n’ai malheureusement pas pu voir De guerre, lasses de Laurent Bécue-Renard qui, justement, évoque des thérapies de travail de deuils des êtres aimés. Sont-ils, au-delà (c’est le cas de le dire) de leur mort, les Destinataires de leurs veuves ?
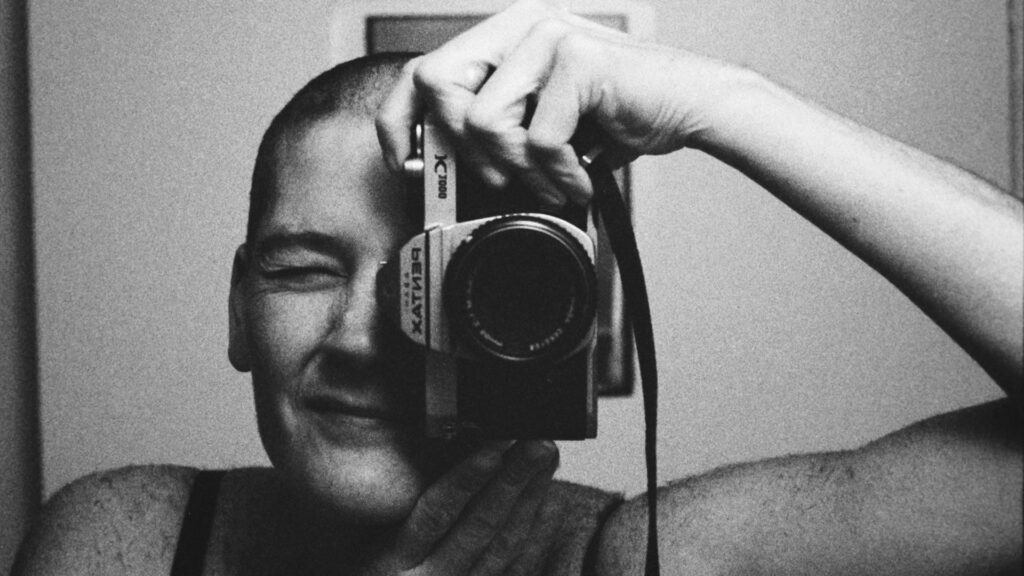
Elle pis son char, film canadien de Loïc Darse. Une femme, le 31 décembre 2003, se filme, ou plutôt est filmée par une caméra qu’elle a coincée dans sa voiture. Elle va donner une lettre en mains « propres » à l’homme qui a abusé d’elle de 8 et 12 ans. Elle dit ses états d’âme durant ce long trajet enneigé, son stress, sa détermination. La caméra saute avec les cahots. Parfois on la perd. Quand enfin elle arrive devant la maison de son bourreau, l’image se brouille, et on ne peut voir l’homme qui ouvre la porte : ce n’est qu’une efflorescence de couleurs irisées et floutées. Que s’est-il donc passé durant la prise ?
Qui est Destinataire de ce dernier film : c’est sans doute elle-même comme dans un dialogue soutenant. Cela rappelle étrangement les dédoublements lors des viols : il y a le corps abusé et la personne qui, pendant l’acte, se défend en le quittant et regarde de haut ce qui lui arrive. Mais il y a un autre Destinataire possible : son fils plus tard, qui est alors un petit garçon.
C’est en effet lui qui reprend en 2015, 12 ans après, les rushes de sa mère pour les monter et projeter le film de 28 minutes pour montrer à tous le courage de sa mère, et sans doute jeter l’opprobre sur le violeur. Mais la censure brouille son dessein.
Nous comprenons alors, à la réflexion, le pourquoi du floutage : il s’agit de protéger le violeur et le repérage de son adresse. Cela n’est pas dû à l’émotion de cette femme, mais aux exigences de la Loi qui a interdit que le village, la demeure du violeur et son visage apparaissent clairement à l’écran, car cela est interdit. Du coup, on ne connaît de l’identité des protagonistes que celle de la victime. Cela rappelle les difficultés pour Les oubliés de la Belle Étoile » de lever la prescription. Qui la Loi protège-t-elle ? Quelles reconnaissance et réparation les victimes sont en droit d’attendre de la société ?
Si l’on reprend cet itinéraire autour du couple Destinateur/Destinataire, nous retiendrons que les Destinataires secrets des protagonistes de ces films : ce sont avant tout, outre la personne qui s’exprime et qui se parle à elle-même à travers une adresse à autrui, d’autres personnes présentes filmées (ou hors cadre). Cela, que le film soit réalisé à la demande ou non des protagonistes ou qu’eux-mêmes s’approprient l’acte de filmer soit directement soit par l’intermédiaire de cinéastes en délicatesse et respect. Ces Destinataires secrets apparaissent à l’écran ou sont évoqués par les personnages filmés qui, inconsciemment ou non, s’adressent à eux et au-delà d’eux, à eux-mêmes.
La leçon du carambar
J’ai trouvé sur l’emballage d’un carambar l’histoire suivante :
« Dans la série “Sans queue ni tête” :
Un fou poste une lettre
— Tu écris maintenant ?
— Oui
— À qui ?
— À moi-même
— Et que te racontes-tu ?
— Je ne sais pas, je ne l’ai pas encore reçue. »
I Pay For Your Story, Lech Kowalski, 2017, France, 86′
Clean Time, le Soleil en plein hiver, Didier Nion ; 1996, Super 8, France, 24′
Les oubliés de la belle Étoile, Clémence Davigo, 2023, France, 106′
Ceci est mon corps, Jérôme Clément-Wilz, France, 54′
Elle pis son char, Loïc Darses, 2015, Canada, 28′