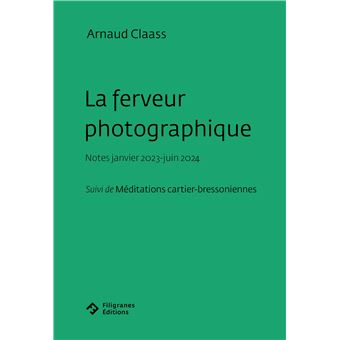
La ferveur photographique
Un nouvel essai d’Arnaud Claass
« Notes 2023-2024 »
Éditions Filigranes
25 euros
ISBN 9 782350 466 408
Commander le livre en librairie
Commander le livre sur le site des éditions Filigranes
Arnaud Claass poursuit chez Filigranes la publication de ses « Notes des années 2023-2024 » sous le titre La ferveur photographique, l’ensemble étant suivi de Méditations cartier-bressoniennes. Ses réflexions reviennent de façon critique sur l’influence de l’inventeur de l’instant décisif. L’ensemble de sa pratique réflexive au quotidien est mené à partir de ses propres images, des conditions de leur réalisation autant que de l’approche philosophique et esthétique d’autres photographes et artistes de son panthéon iconique.
Ses Notes poursuivent la retranscription subtile de ses notations visuelles fugaces, elles relatent des rencontres sensibles avec des objets, des lieux, des atmosphères, des lumières ou des personnes. Elles font preuve d’un sens aigu de la formule qui donne à voir et à ressentir. On y retrouve ses sortes de haïkus limités au dernier vers établissant la transformation de la situation exposée. Revenant sur sa pratique de prise de vue, le photographe analyse ses sentiments et états d’esprit à ce moment décisif, y compris quand l’expérience aboutit à une photo ratée.
Conscient des limites de cette action de transcription constante d’une pratique à une autre, il témoigne de ce paradoxe : « Depuis 50 ans j’essaye de mettre en mots ce que les images disent si bien sans les mots ».
Il assume un positionnement critique déjà affirmé au fil de ses précédents livres pour une photographie directe contre les pratiques sérielles, et un certain nombre de créations plasticiennes. Il a le sens là aussi des formules qui font sens dans une expression restant poétique, défendant « la préméditation photographique comme une tentative de prophétie au royaume du hasard » ou « chaque image un cessez-le-feu dans la guerre du temps »
D’un point de vue critique positif, cela l’amène à signaler et à défendre des publications récentes d’auteur-e-s illustrant son esthétique, c’est l’occasion d’attirer notre attention principalement sur des monographies comme celle d’Inge Morath chez Schirmer/Mosel, Stéphane Mandelbaum aux éditions Martin de Halleux ou Haïti de Bruce Gilden, tous déjà bien repérés. C’est aussi pour nous la possibilité de découvertes, comme l’approche de l’intime par l’américain Raymond Meeks. Cela donne encore l’occasion de noter des manques de reconnaissance institutionnelle, comme l’absence de rétrospective de Luc Chessex. Ce panthéon est le plus souvent américain à travers des livres comme France 1987 de Mark Steinmetz ou The True America d’Ernest Cole chez Aperture.
Dans ses révisions ou relectures de l’histoire de l’art, on apprécie qu’il rende hommage aux photographies de Magritte ou qu’il examine avec précision un certain nombre de tableaux du XIXe siècle, ou qu’il salue l’œuvre du peintre Indien S.H. Raza au Centre Georges Pompidou ou celle de son confrère chinois Qui Shihua chez Karstent Greve. Et, dans le domaine de l’image, on ne peut qu’adhérer à sa défense de la présentation de l’exposition Tina Modotti, L’œil de la révolution au Jeu de Paume.
En revanche, une agressivité théorique à l’encontre de plusieurs expositions, notamment présentées au Palais de Tokyo, manque souvent d’arguments, qu’elle attaque Miriam Cahn et sa pensée sérielle, l’engagement sincère et plastiquement diversifié d’un Taysir Banitji qu’il oppose à la démarche certes intéressante, mais très classique de Paola de Pïetri. On ne peut accepter non plus, sans protester, la longue diatribe contre la remarquable exposition Signal de Mohamed Bourouissa toujours dans le même lieu honni !
Dans son retour sur Cartier-Bresson, il l’associe en tant qu’expérience primitive à la découverte à la même époque de la peinture d’Edward Hopper. Une comparaison est bien évidemment menée avec le style de l’œuvre de Robert Frank. Une autre comparaison transatlantique met en balance la représentation du travail d’HCB pour L’homme et la machine et celle de Lee Friedlander dans At Work.
De nombreuses Notes de cette méditation s’attachent à définir la pratique dans des formules croisées, telles « Il envisageait les paysages et paysageait les visages » ou « En même temps qu’elle narre, cette image songe ». Les formules critiques se succèdent pour évoquer ses images comme « accumulateurs, stockages d’attractions des champs, traversées de flux » « un espace de contention explosive » et « L’instant décisif comme disharmonie excitée ».
Par rapport aux précédents ouvrages, certaines photos sont décrites ou simplement suggérées en tercets de vers courts :
« Enfants ombreux
Sur la crête de l’ombre
Au loin faubourg éclatant »
Arnaud Claass questionne encore les liens de Cartier-Bresson aux autres civilisations à travers les recherches de ses contemporains, l’écrivain Michel Leiris, l’anthropologue Marcel Griaule ou le poète Victor Segalen.
Vu la diversité de son action, l’importance exercée par son œuvre et ses protocoles sur plusieurs générations de photographes en France et dans le monde, il est judicieux de jauger aujourd’hui objectivement son œuvre.
À relire :